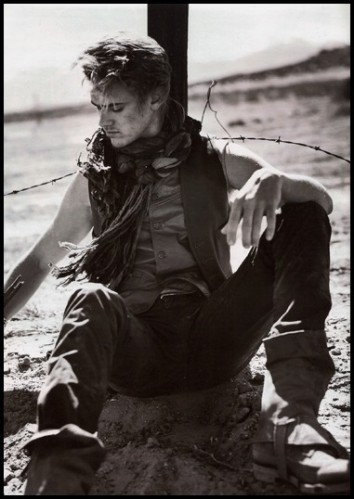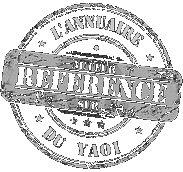Siii! Vous ne rêvez pas! J'y suis arrivée! J'ai réécris ce chapitre qui était tellement parfait avant d'être bouffé par un virus!
Alors forcément, la qualité est moindre, ce sera juste passable, mais j'ai réussi! Bon dieu quelle victoire!
Vu que je suis un peu crevée, je vais zapper l'intro de cinquante ligne habituelle. Juste quelques petites choses:
-Allez lire les défis!
-Essayez d'en faire, qu'on rigole un peu!
-Pensez à faire un tour sur les blogs amis, il y a une petite nouvelle qui mérite d'être lue, et puis plein d'autres que vous devez découvrir ou redécouvrir!

{les deux photos sortent de je sais plus quel dossier de travesti sur homotography, je les trouve magnifiques ^^)
Si entre deux majs vous êtes trop impatientes, allez lire les DNA, c'est plein d'excuses bidons pour vous faire patienter.
Allez zou ta gueule la créa!
Ceci est un chapitre du point de vue d'Ambre, et JE SAIS que les flashs backs ça vous emmerde, moi aussi, je déteste les lire. Mais quand on est "auteur" on aime Aussi causer du passé mystérieux de nos personnages. Alors faites les hypocrites pour une fois, et appréciez =)
Bisous, je vous aime. {Ouai enfin j'aime les quelques survivors qui trainent dans le coin!)
Chapitre 17:
J’ouvre les yeux sur une salle trouble. Entre fumée et vapeur d’eau, les faibles rayons des flammes dans les bougeoirs paraissent verts, oranges, rouge et or, et chaque particule de lumière se reflète sur les gouttes d’eau, parant la pièce de mille diadèmes aux pierres enchanteresses. Les bassins d’eau chaude et la roche qui les entoure se teintent de mille couleurs chaudes et hypnotisantes. Les corps sont sublimés par le faible éclairage, sculptant chaque défaut comme un bijou dont on se pare sans honte, la sueur et l’eau les fait scintiller, leurs mouvements alourdis par les effluves d’encens sont comme transformés : les muscles se détendent, les gestes des plus nerveux deviennent langoureux, précis, dôtés d’une grâce qu’ici seul ils font preuve.
Mes lèvres s’entre ouvrent et j’aspire une bouffée d’air humide, chaud, et parfumé qui roule sur ma langue. Une goutte de sueur glisse entre mes yeux et je repousse d’une main les cheveux d’un blond trop clair qui obstruent ma vue. Mes doigts se crispent une seconde sur le torse que je pétrissais auparavant. Quelque chose ne va pas. Et ce quelque chose je le connais. Une réminiscence du passé. Pourquoi faudrait-il que cela arrive maintenant que je suis heureux ?
Mon ventre se tord et mon souffle se coupe. Je suis comme trop éveillé à cet instant. Comme si j’étais le seul à avoir une capacité de réflexion accélérée dans la salle.
D’un mouvement je me redresse du rebord de pierre immergé sur lequel mon partenaire et moi somme installés. L’eau glisse sur ma peau et n’atteint plus que mes genoux, pourtant je n’ai pas froid. La verge encore dure de l’homme entre mes jambes retombe contre son ventre, et s’il n’y avait eu l’eau l’entourant, aurait fait un bruit de succion mouillée que j’aurais adoré entendre.
Je lève une jambe et me hisse sur le rebord du bassin lorsqu’une main s’enroule autour de ma cheville. Je me retourne, enroulant un tissu crème qui parait doré sous la lumière autour de mes hanches, et sens son visage se presser contre la chair de mes mollets ses doigts malaxant ma peau comme l’on apprécierait la fermeté et la douceur d’un fruit, sachant très bien qu’en dessous se trouve le jus le plus sucré qu’il soit.
-Je reviens, je souffle en me détournant et dégageant mes jambes de son emprise.
J’avance de quelques pas, enjambe le corps d’un homme alangui, profitant de la pierre chaude après avoir pris du plaisir, les traces de sa jouissance encore sur son torse, et me baisse pour passer sous l’arche de plantes tropicales qui mènent à une autre partie de la salle de bains. Enfin, j’atteins les lavabos de cuivre, et m’asperge le visage d’eau fraiche avant de me redresser et d’essuyer la buée matifiant la glace.
Mes yeux m’apparaissent décalés sur mon visage. Trop gris. Aux iris bien trop grands, aux pupilles pas assez dilatées pour l’obscurité ambiante. Presque argentés. Presque inhumains.
Mon doigt se pose sur ma joue et je me fixe encore. Presque une anomalie de la nature.
Deux mains chaudes glissent sur ma taille et je laisse tomber ma tête en arrière, sur une épaule que je connais, qui me soutient et m’a toujours soutenu. Sur quelqu’un qui m’a accepté. Comme je suis, comme cette autre espèce à laquelle j’appartiens. Qui me voit.
-Ambre, tout va bien ? La voix d’Indigo se fait rauque à mon oreille, et son souffle saccadé me donne l’idée qu’il a abandonné une activité plus intéressante pour venir me secourir.
-Oui. Je réfléchis, c’est tout.
-Avec la couleur de tes cheveux, tu sais bien que tu ne devrais pas.
Je l’entends rire à sa blague et mon cœur se réchauffe instantanément. Je m’apprête à sourire, mais mes yeux croisent ceux de mon reflet. Vides.
Et soudain tout se brouille tout disparait. Et je revois les mêmes images qu’à chaque fois. Comme si je ne pouvais aller de l’avant sans que ces horreurs se rappellent à moi.
Il fait jour. Les rayons du soleil passent par la fenêtre pour venir frapper la moquette à quelques centimètres d’où je suis assis. Mes doigts s’enfoncent dans l’épais tissu beige sale et je peux le sentir tiédir là ou il est éclairé. Mes jambes encore potelées de l’enfance s’étendent devant moi, de petites chaussettes à motifs entourent mes pieds jusqu’à la moitié de mes mollets. Si petits. Tellement petits. J’ai sept ans. Un livre ouvert repose à mes côtés. Ses grandes images colorées n’ont pour spectateur qu’elles même. Moi, je fixe autre chose.
Dans mon champ de vision, le bas du fauteuil brun paternel. Un cendrier à pied, autour duquel la moquette est grise de cendres perdues. Et les jambes de mon père. Ses pieds enfoncés dans ses épais chaussons bleus, un trou de cigarette dans la couture de celui de son pied droit.
Les jambes nues jusqu’au genou de mon père. Il fait chaud, c’est l’été. Il porte une espèce de bermuda kaki, le genre de vêtement de randonnée, bien confortable. Bien large. Du type qui baille à la moindre occasion et qui ne cache pas grand-chose. Nous y voilà. D’où je me tiens je vois le bas de ses jambes nues, sa main qui fait des allées et venues entre l’accoudoir, ses lèvres, et le cendrier, et surtout… Surtout…
Cet espace entre son genou et le siège, ce petit espace qui dévoile la peau de sa cuisse mate, qui suggère encore tant de surface de peau à parcourir du regard mais qui s’éclipse de ma vision et s’engouffre dans l’obscurité.
Je l’entends soupirer. Il est fatigué. De plus en plus chaque jour. A cause d’un combat qu’il ne devrait pas avoir à mener. Un combat qui oppose ses sentiments et sa bonté d’homme d’honneur, d’homme droit et de père aimant à ceux, contradictoires qu’il ressent lorsque je suis dans les parages. Sept ans qu’il tient. Cinq ans de souffrance. Je le sais, je le sens. Sa douleur est palpable. Son labeur est sans fin. Il va craquer il est humain. Et plus je le sens, plus inconsciemment je le suis, le harcelant de ma présence innocente comme un chat dans une cuisine alors que le poulet est presque prêt.
Ses doigts tremblent alors qu’il fait tomber sa cendre dans le cendrier. Cinq années qu’il passe à m’écarter des autres hommes. Des collègues, des voisins, des maitres d’école, des réparateurs et des passants. Cinq années qu’il s’éclipse lorsqu’il se sent à bout. Cinq années qu’il revient à temps pour m’extirper des griffes de ma mère impassible alors qu’elle maintient ma tête sous l’eau tandis que je me débats.
Tout ce temps à m’aimer comme le merveilleux père qu’il est et non comme un amant.
Sauf que chaque jour la faim en moi se décuple. C’est comme une famine. Une douleur sourde avec laquelle j’ai vécu depuis ma naissance et que je ne sais comment satisfaire. Sinon me laisser aller dans la direction que mon corps me montre.
Et pour l’instant, ma main se tend vers ses pieds, mes ongles crissent sur le tissu bleu de ses chaussons, mes doigts ondulent à travers les poils de ses mollets, et remonte… Remonte… Le pli du genou… Le tissu se plisse et…
Et deux jours plus tard, celui que j’appelais « père » se pendait à la tringle du rideau de ma chambre, après m’avoir demandé pardon pendant des heures, écroulé au pied du lit sur lequel je reposais, comblé pour la première fois.
Il n’y a que depuis que je connais Indigo que j’ai saisi toute l’horreur du désir charnel chez un enfant pré pubère. Et encore, je n’arrive pas à ressentir cette répulsion, ce dégoût viscéral dans lequel ont baigné tous ceux qui m’ont approché avant mes quatorze ans.
Et Dieu et Diable savent qu’il y en a eu beaucoup.
Aujourd’hui, je me souviens de la peine que j’ai ressentie à perdre celui qui m’a aimé si longtemps sans me toucher. Le seul, l’unique à m’avoir protégé de tout, même de moi.
Aujourd’hui… Aujourd’hui je me hais au souvenir du premier geste que j’ai fait lorsque j’ai compris qu’il était mort.
Je revois clairement, comme un dessin macabre, ma main si blanche se tendre dans l’obscurité, traverser un rayon de lune qui faisait paraitre la pièce bleue, et tenter d’atteindre cette forme qui tendait le pantalon de son pyjama. Cette érection mortuaire que j’aurais du éclipser de ma mémoire au profit de son visage torturé.
Après sa mort je n’eus plus jamais faim. Mais personne ne m’aimât jamais comme lui. D’un amour filial sans que nous n’ayons la moindre parcelle d’ADN en commun. Et chaque jour qui passait me laissait un goût sur la langue, pas un goût amer, une saveur vraiment immonde, comme si toute mon âme se soulevait contre ma nature.
Les années défilèrent, entre nuits passées entre les bras de routiers, de mes professeurs, et celles de terreur dans ma propre maison. Personne ne s’était jamais étonné de ma présence dans cette famille. Personne ne s’était jamais posé la moindre foutue question sur le fait que mes parents aient pu donner naissance à un enfant au teint de lune et aux cheveux d’argent alors qu’ils étaient bruns au teint mat.
Le fait que ma sœur ait un mois d’écart avec moi non plus. Chaque fois que le sujet était abordé d’une façon ou d’une autre, les occupants de la pièce se transformaient en poupées. Des poupées automatiques qui soudainement semblaient d’une sérénité à toute épreuve lorsqu’elles changeaient fermement de sujet. Non. Elles ne changeaient pas de sujet, c’était comme s’il était effacé de leurs esprits. Et je restais là, figé, sans comprendre, à prendre entre mes cuisses chaque homme ou jeune garçon qui passait près de moi.
Lorsqu’ils étaient forts, ils fuyaient loin de mon quartier après avoir cédé. Lorsqu’ils avaient un tant soit peu de sens moral, ils se réfugiaient vers l’Eglise, se tuaient ou venaient me revoir pour s’excuser et échouaient. Quoi que l’on puisse croire, les hommes qui couchent avec des enfants ne sont pas si nombreux que ça. Et les quelques uns que j’ai pu croiser ont vite compris qu’entre eux et moi c’était moi le prédateur. Ils étaient ma nourriture, mon moyen de survie, leur plaisir était mien, leur corps était mien, leur jouissance m’appartenait. Et je jubilais de leur visage défait alors que je prenais le dessus et les chevauchais sans hésitation plutôt que de les laisser me prendre comme l’enfant perdu et tordu de douleur que j’aurais du être.
Ce fut lorsque j’eus quinze ans que tout changea. Enfin… Que tout évolua.
J’avais depuis longtemps appris à éviter les hommes qui approchaient ma famille, les futurs amants, amis, maris de mes sœurs ou de ma mère. Mais manque de chance pour elles, pour eux, et aussi pour moi, leur présence un peu trop fréquente faisait souvent qu’eux et moi craquions. Et c’est ainsi qu’un jour pluvieux d’avril, je me réveillais enfermé dans le grenier de la maison, glacial, sale, et désespérément vide, comme depuis maintenant vingt jours. Ou vingt cinq. Je ne savais plus.
Mes yeux secs se dirigèrent douloureusement vers le vase que j’avais placé sous la fenêtre pour récupérer l’eau de pluie, et je me trainais jusque là pour boire à grandes gorgées.
Cela faisait une semaine que je m’étonnais de la résistance de mon corps. J’avais compris depuis quelques années que je pouvais tenir deux semaines sans manger sans en mourir, vu le nombre de fois que ma famille m’enfermait dans la cave lorsque je descendais faire mon linge. Et la déception sur leur visage lorsqu’à chaque fois elles ouvraient la porte concurrençait largement mon étonnement d’être en vie.
Bien sur, l’eau était indispensable, mais la nourriture non. Forcément je perdais du poids, mais n’en mourrais pas. Sauf qu’en ce jour d’avril, je sentis que j’avais atteint ma limite. Tout mon corps se tendait désespérément à la recherche d’un contact avec le sexe opposé. Et définitivement non, la masturbation ne comptait pas.
Je me laissais aller à l’agonie, mes muscles parcourus de chocs nerveux. J’allais crever là, comme la dernière des catins enfermée dans un grenier parce qu’elle devient gênante.
Quelle honte. Quelle rage. Et quelle fin de vie ridicule.
La porte était renforcée, les cloisons donnaient sur le toit, et le plancher avait refusé de céder depuis presque un mois. Je ne voyais plus qu’une solution.
Et mon regard se tourna vers le ciel gris qui déversait une pluie froide en continu.
Non, je me fis une raison. Autant mourir là, plutôt que de me vautrer du haut du toit en nourrissant l’espoir de m’en sortir.
Mon souffle se faisait erratique. Faible… et erratique. C’était dur à combiner, et d’autant plus douloureux.
Lorsqu’enfin je laissais mes paupières se fermer, j’entendis sonner à la porte. Une fraction de seconde plus tard mes yeux étaient prêts à sauter de leurs orbites, et mon torse se gonflait d’air.
Des hommes. Plusieurs. Peut-être deux. Non trois.
Mon corps par réflexe se tendit vers la porte du grenier.
« Non… Le toit. »
Il doit être quatre heures. Une odeur de thé et d’immondes muffins embaume certainement tout le rez de chaussée.
Sans doute un père et ses deux fils, ou deux amis et le père de l’un deux, ou trois inconnus.
Il est quatre heures, on doit être dimanche, ils sont sans doute assis sur le canapé du salon.
Il est quatre heures, il pleut, et les toits glissent comme s’ils étaient recouverts d’une mousse gorgée d’eau. De la vase peut-être.
Il est quatre heures et putain, le sol était loin.
Maintenant que j’ai le nez dans l’herbe et la terre spongieuse, je le trouve beaucoup trop près.
Je relève la tête et ma nuque semble prête à céder. Je regarde à gauche, à droite. L’abri du jardin est plus près que la porte d’entrée.
Mes muscles se tendent une seconde et je m’écroule. Ramper, c’est pas si mal en fait. Ma cheville me fait un mal de chien.
Une demi heure passe. Je suis couvert de boue. L’abri n’est plus qu’à un mètre et la pelouse devrait être tondue. J’entends un claquement de porte et une délicieuse odeur vient à moi.
Enfin.
Je roule sur le dos et relève légèrement la tête. Ils sont trois, sortis fumer le cigare du dimanche.
La fumée disparait entre les gouttes d’eau tandis qu’ils se serrent sous le porche pour éviter la pluie.
Des rires gras résonnent . Qu’ils tournent le regard par ici !
Je me sens défaillir et lorsque mes yeux se r’ouvrent, c’est pour tomber nez à nez avec mes sauveurs.
-Eh là gamin ! Ouvre les yeux !
J’étais sauvé. Et à peine l’un eut touché ma peau que je me sentais revivre et mes jambes s’enroulaient autour de ses hanches comme un étau. Mais ce n’était pas assez, il me les fallait tous. Tout les trois. Peut importe qui ils étaient, à quoi ils ressemblaient. Ce qu’ils voulaient à cet instant c’était moi, et uniquement moi, et ça parce que je le voulais.
Nous fûmes pris sur le fait. Une petite demi heure plus tard. Assez longue pour que je gise allongé sur la terre meuble, comblé, comme un amateur de gastronomie après un repas dans un quatre étoiles. Mes jambes pleines de foutre et de boue étaient légèrement repliées, écartées sans gène et un liquide chaud et poisseux glissait de ma joue à mon cou.
Mon cerveau était abruti par la satiété. Aussi je ne m’aperçus du changement de partenaires que lorsqu’un marteau entra en contact avec ma bouche. Ma tête vola littéralement en arrière et le hurlement de douleur que je voulus pousser fut coupé par le vomissement de sang qui émergea de mes lèvres. Je roulais sur le ventre et laissais ma bouche béer tandis que dents, salive et sang glissaient tristement sur la terre de la cabane. La douleur était si diffuse dans mon visage que les larmes obstruaient ma vue sans que j’eusse la moindre intention de pleurer.
Mes ongles s’enfoncèrent dans le sol et enfin le cri de souffrance retenu par mes hoquets put sortir.
Long, rauque, presque animal. Le genre de cri d’agonie qui me hante encore aujourd’hui alors que c’est moi qui l’ai poussé.
Un haut le cœur me pris lorsque le pied de ma mère s’enfonça dans mes côtes, puis dans mon ventre, et les poings de mes sœurs dans mon visage.
Folles. Ce fut le seul mot qui me vint à l’esprit. Elles par contre eurent tout le temps de me qualifier de monstre, de bête, de démon, de chienne et de faire trois fois le tour du dictionnaire avant de me lâcher et de se diriger vers un seau d’eau pour se nettoyer. Otant le sang de leur visage avec la délicatesse d’une future mariée nerveuse et apprêtée. Les cols furent remis en place, les chemises lissées, de charmants gloussements se firent entendre et leurs pas joyeux et insouciants s’éloignèrent de la cabane. Je compris que j’étais devant le même phénomène que l’attrait qu’éprouvaient les hommes pour moi, et la béatitude dont faisaient preuve ceux qui relevaient l’étrangeté de mon existence.
J’ouvrais les yeux sur un abri vide. Ca devait être la huitième fois que je défaillais aujourd’hui.
J’étais sur le ventre, et je repliais mes genoux sous moi pour me redresser. Une douleur fulgurante traversa mon corps du bas de mes reins jusqu’à ma nuque et je serrais les dents. Ou plutôt j’essayais et les moignons encore présents dans ma bouche s’entrechoquèrent avec mes gencives en lambeaux.
« Hie he herhe huhin ». Ce que j’avais voulu dire c’était « vie de merde, putain ». Je me redressais sur mes jambes tremblantes et baissais les yeux vers mes cuisses maculées de boue et de sang séché. A peine l’eus je pensé que de nouvelles coulées d’un rouge plus vif s’ajoutèrent au dernières et ma main partit entre mes fesses retirer un petit quelque chose qui n’aurait pas du y être.
Une vis. Sans déconner. Je fixais l’objet à la lumière d’un rayon de réverbère qui pénétrait dans la cabane. J’étais sceptique. La douleur était terrible. Et si elles s’étaient amusées à me torturer pendant mon inconscience, je devinais que je devais être dans le pire des états. Il n’y avait plus qu’à espérer que ce qui avait décidé que j’attirerais les hommes, rendrait les femmes pleines de haine avait prévu un petit quelque chose pour la résistance à l’hémorragie.
Une heure plus tard, je me trainais le long d’une route en direction d’un arrêt de bus. Oh bien sur je marchais. Mais à la vitesse d’un vieillard boiteux. Voire pire.
Je m’approchais de l’abribus et distinguais une autre silhouette avachie sur le banc, un gros sac à ses pieds. La lumière du néon clignotant me fit apercevoir des cheveux d’un châtain lumineux, un teint doré comme celui d’un surfeur, et surtout, une aiguille plantée dans un avant bras, juste avant que le jeune homme ne me remarque. Je m’affalais contre la vitre et contemplais rapidement mon reflet. A part avoir l’air de m’être fait tabasser, j’avais l’air plutôt normal. Pas trop de sang.
Lorsqu’il me vit, il fit un bond en arrière, se plaquant contre le coin de l’abribus, s’emmêlant les pieds dans son sac. Je tournais des yeux interrogateurs vers lui et le vis appuyer sa tête contre la vitre pour lever les yeux au ciel et se répéter comme un mantra.
-C’est un humain. Ca n’existe pas. Ca n’existe pas. Normal. Humain. Tout va bien. Humain. Hum…
J’étais intrigué, c’était une des premières fois que quelqu’un semblait avoir peur de moi. J’avais vu des hommes étonnés, attirés, dégoûtés, mais jamais effrayés.
Je me tournais à nouveau vers la vitre. Non, à part deux cocards en formation j’avais l’air tout à fait normal. Mon absence de dentition ne se voyait pas, j’avais la bouche fermée. Je ne comprenais pas.
Je me recoiffais et me déplaçais de quelques pas, pour me mettre dans son champ de vision. Ca a toujours marché. Toujours. Les coups et la faim n’ont jamais altéré le pouvoir que j’exerçais sur les hommes.
La seringue tomba au sol et il poussa un soupir. Je continuais de l’observer et les secondes passant il se détendit.
…Pour finir par se mettre à rire d’un rire de personne défoncée, terriblement à l’ouest. Il pointa son doigt vers moi et l’agita négativement alors que je le fixais, de plus en plus agacé.
-Nan nan, nan mon petit. Tu ne m’auras pas. Je te vois. Je te vois, et maintenant que je suis au 7ème, je peux le dire sans passer pour un fou. Je sais ce que tu es. Je te vois. Et tu ne m’auras pas.
Je me laissais tomber au sol, ébahi. Il ne se passait rien. Il n’éprouvait ni intérêt ni désir. Rien.
Il savait ce que j’étais alors que moi-même je l’ignorais.
Je venais de rencontrer Indigo.
Et il me voyait.
Ecrire un commentaire - Voir les 55 commentaires